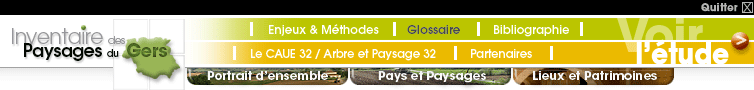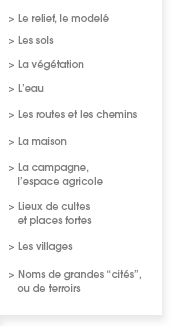 |
 |
 |
Arrajadé
(arrajader) : rajada, c’est le rayon de soleil ; arrajadé
signifie lieu “irradié”, c’est-à-dire
un endroit ensoleillé, généralement sec et
élevé. Synonyme de soulan.
Anglade : “angle”,
triangle formé par l’atterrissement qui raccorde le
bas fond des vallons à la plaine alluviale des rivières.
Boubée (bobéa) :
désigne le versant peu pentu aux terres généralement
légères (boulbènes), situé à
l’est des vallées gasconnes.
Coume (coma) : bas-fond des vallons
et, par extension, l’ensemble du vallon en tant qu’unité
topographique (forme du relief) et que bassin hydrographique élémentaire,
à rapprocher de “combe”.
Darre : de derrière, situé
au couchant.
Davan : de devant, situé
au levant.
Paguère (paguèra)
: versant des collines exposé au nord, à l’ombrée.
Ribère (Ribèra, ou arribèra)
: la rivière et par extension, l’espace qu’elle
a aplani ; la plaine alluviale, le lit majeur dans lequel elle peut
épandre ses crues.
Plagne (planha) : terrasse supérieure
de la plaine alluviale des rivières.
Pouy (poi) : colline dégagée et dominante (Pouyloubrin,
Puységur, Gazaupouy…).
Ribère : la rivière gasconne et sa plaine alluviale
Serre (sèrra) : mot français issu de l’occitan.
Hauteur, colline allongée, au relief marqué qui, en
Gascogne, correspond au coteau d’interfluve. Désigne
le versant abrupt du coteau (rive droite des cours d’eau)
et sa partie sommitale. Étymologie : serare qui signifie
“fermer”, “barrer”, “protéger”
: la serre effectivement barre, ferme l’horizon des paysages
de vallée comme elle la protège des flux climatiques
dominants.
Soulan (solan) : versant exposé au sud, au soleil.
Tucò, tuc : mot d’origine celte désignant
une hauteur, une proéminence, voire une forme pointue, c’est-àdire
une colline naturelle ou artificielle (motte, tumulus) qui se distingue
de son environnement.
Tupé (tupèr) : signification proche de “Tuco”,
avec une notion de situation dominante et dégagée
: promontoire. |
 |
Bouhec (bohèc)
: sol argileux, compact, généralement non calcaire et
situé sur les coteaux. Il est peu fertile et très difficile
à cultiver.
Boulbène : terme gascon et répandu dans le Sud-Ouest.
Terres siliceuses et limoneuses, donnant des sols non calcaires acides
et relativement légers. Par extension : ce qui n’est
pas terrefort, c’est-à-dire selon les contrées,
des types de sols très diversifiés. “Boulbène”
est peut-être à rapprocher de “boue”, du
fait de son caractère boueux, collant, glaiseux, lorsqu’elle
est mouillée.
Marbouc : sol compact, très peu fertile composé
d’argile et de cailloutis, voire de galets.
Mournac (mornac) : plaque d’argile de plus ou moins grande
étendue, au milieu d’un champ en culture.
Peyrusquet (peirusquet) : sol superficiel, calcaire. Peyrusquet
désigne à la fois le type de sol et, par extension,
le replat ou le plateau calcaire sur lequel il repose.
Terrefort (terrahòrt) : “terre forte”, ferme
et lourde, calcaire ou non, généralement fertile mais
difficile à travailler.
Terrebouc : sol naturellement cimenté, compact, synonyme
de grep ou de tuf. |
 |
Bòsc ; boscarôt
: bois ; bosquet
Bouzigue (bosiga) : friche, “lande à genêts”,
généralement installée spontanément après
l’abandon d’un pâturage ou d’une culture.
Buscagno (buscanha) : boisement de Chênes sur un replat
ou un petit plateau calcaire ; toponyme rencontré en Ténarèze.
Cantero (cantèra) : boisement sommital des buttes calcaires
caractéristiques du pays d’Auch.
Cassou (casso) : Chêne au sens large, mais que l’on
peut distinguer du Garric, le Chêne pubescent nommé Chêne
noir en Gascogne.
Garena : Chênaie, bosquet plutôt destiné
à la chasse.
Garric : de la racine “gar” qui signifie à
la fois “rocher” et “chêne”, sans doute
du fait de la dureté de son bois et par allusion au milieu
rupestre auquel il peut s’adapter. Le Garric, c’est le
“Chêne noir” ou Chêne pubescent (appelé
Chêne blanc en Méditerranée), nommé ainsi
notamment pour la couleur de son tronc et pour sa silhouette rabougrie,
sur les terrains maigres et arides des coteaux secs, formant de veritables
“garrigues”, à la gasconne, parfois très
chétives, que l’on nommait “garrabosta”.
Plus rarement, “Garric” désigne aussi le chêne
vert, ou yeuse, qui peut pousser dans ces mêmes milieux.
Gimbrèda : lieu occupé par le Genévrier
(gimbre en gascon).
Haget : Hêtre, toponyme fréquent témoignant
d’une présence de Hêtres nettement plus marquée
qu’aujourd’hui ; l’arbre a presque disparu de la
Gascogne gersoise.
Lanne (lana) : “lande” au sens de terrain maigre
et improductif, généralement plat et sablonneux. Désigne
des pièces de terre comme des terroirs plus étendus
: Lannemaignan, lannemezan, lannes…
Rendail (rendalh) : boisement généralement linéaire
se développant sur les affleurements calcaires en bordure des
bancs et des plateaux.
Ripisylve : du latin ripa (rive) et silva (forêt), végétation
des berges et, par extension, de la Ribère.
Saligue (saliga) : végétation des berges, à
base de saule (lat. salix) occupant les rives de l’Adour et
de ses principaux affluents.
Segàs : haie, broussaille coupée, taillée
ou contenue car segar signifie “tailler”.
Seuva : forêt, du lat. silva (Masseube, Lasseube…).
Touja, touyà : lande arbustive sur sols siliceux et
acides, constituée d’une végétation de
genets à balais, bruyères, ajoncs, … autrefois
utilisés pour la litière des animaux. |
 |
Arriou (arriu) ou riou
: riou, ruisseau en gascon, affluent à la rivière.
Aturin : du latin Aturus, Adour, de la racine “tur”
ou “dur” fréquemment utilisé pour nommer
les rivières (Dordogne, Durance, Dourdou… relatif à
l’Adour et aux pays de l’Adour. Syn. peu usité
: adourais, adourin.
Barthe (barta) : désigne la basse terrasse inondable
près de la rivière.
Lac : lat. lacum qui signifie “lac” ou “mare”.
Pachère (paishèra) : lieu lié à
la présence de l’eau, susceptible d’être
inondé naturellement ; désigne aussi le barrage permettant
de l’inonder artificiellement à l’aide de paches
(pieux). |
 |
Mercadère (mercadèra)
: route des plaines ou route des ribères, voies marchandes
aménagées pour faciliter le déplacement des marchandises
dès la création des bastides.
Poutge, poutche (potge) : voie généralement étroite
longeant la rivière contre le versant abrupt des coteaux. Existait
bien avant la mercadère qui la double en rive gauche.
Travers (travèrs) : voie permettant le franchissement
transversal des coteaux et des vallées, reliant généralement
la serrade à la mercadère.
Serrade (serrada) : voirie empruntant la serre et longeant
sa ligne de crête. |
 |
Borde (bordà)
: la métairie en Gascogne correspond au terme générique
de ferme dans le sens de maison du paysan. “Borde” exprime
à la fois la maison – relativement modeste – et
l’ensemble de ses dépendances bâties (granges,
étables etc.) en étroite relation avec ses terres affectées
traditionnellement à la polyculture vivrière. La borde
dépendait d’un domaine ou d’un château et
était exploitée en métayage par le bordier.
Maysoû : la maison, comme en français, du latin
manere: rester. L’endroit où l’on “reste”,
comme on le dit en Gascogne, où l’on habite. Le domicile.
Casau : maison avec de la terre attenante, maison avec son
jardin.
Oustau : la maison, en tant que logis et lieu de travail du
paysan, de sa famille, des domestiques.
La maison vue sous l’angle de l’habitation avec une notion
d’abri, de refuge, mais aussi sous ses différents aspects
utilitaires. |
 |
Artigue, lartigue (artiga)
: terrain défriché, l’équivalent d’essart
en langue d’oil.
Barat (varat) : mot gascon désignant le fossé,
le fossé comme obstacle qui “barre”, qui ferme
et limite.
Bartas (bartàs) : fossé au sens large : dans
les champs, près des chemins, comme désignant les douves
d’un château ou d’un village fortifié.
Pacherenc : pieux en rang. Nom d’un cépage autrefois
cultivé en hautains et qui désigne aujourd’hui
les vins blancs du madiranais.
Peça : pièce de terre, parcelle, champ cultivé.
Prade (prada) : prairie, plus étendue que le “prat”.
Prat : le pré. |
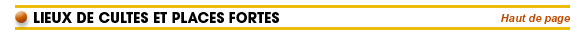 |
Capèra
: chapelle.
Glèisa : église. La Gleize, Glezia, Lagleize
etc. sont des toponymes relativement fréquents qui indiqueraient
l’emplacement d’églises extrêmement anciennes
et – peut-être préromanes – aujourd’hui
disparues.
Castet (castèth) : château.
Lafitte, lahitte (lahito) : mot gascon signifiant une pierre
plantée, fichée, servant de borne, et désignant
par extension les "hameaux".
Mòta : motte féodale. Levée de terre artificielle |
 |
Barri : mot
gascon désignant le “faubourg”.
Couderc (codèrc) : pré communal, pré collectif
des villageois.
Mercat : le marché.
Padouenc (padoenc) : espace “communal”, généralement
peu entretenu : pré, lande. |
 |
Aire-sur-l’Adour
: une des antiques capitales de l’espace gascon, où s’établit
le roi wisigoth Alaric à la fin du Ve siècle ap. J.-C.
Une des capitales de la Rivière-Basse.
Aquitaine : d’Aquitania, pays de l’eau, ou pays
près de l’eau. Ce qui, en l’occurrence, convient
à définir les caractéristiques des pays sud-garonnais.
Gallos ab Aquitanis Garumna flumen dividit, dixit César : la
Garonne sépare les Gaulois (au nord)des Aquitains. Les Aquitains
étaient un ensemble de peuples, voire de petits royaumes, aux
mœurs sensiblement différents du reste de la Gaule. Les
Aquitains ont été les “premiers” Gascons.
Le nom Aquitania a par la suite évolué pour désigner
les contrées nord-Garonnaises par déformation du mot
: Aquitania – Aquidania – Guidania – Guiania qui
a donné “Guyenne”.
Auch : préfecture du Gers. À l’origine
: Elimberris, capitale de la peuplade aquitaine des Ausci qui devint
à l’époque romaine Augusta Auscorum. Capitale
administrative militaire et religieuse des Gascons à différentes
périodes de leur histoire.
Condom : sous-préfecture du Gers à la confluence
de la Baïse et de la Gèle ; étymologie supposée
: condatamagos : marché (magos) du confluent (condate). Rien
à voir avec les préservatifs d’outre-Manche.
Eauze ( Elusa) : capitale des Élusates et de la Novempopulanie
romaine ; une des capitales de la Gascogne historique et aujourd’hui
de l’Armagnac.
Lectoure : Lactora. Cité romaine importante et influente
dans tout le Sud-Garonnais. Capitale des Lactorates et aujourd’hui
capitale de la Lomagne gersoise.
Mirande : sous-préfecture du Gers. Autrefois surnommée
Mirande-la-jolie. Bastide fondée en 1281 par le comte d’Armagnac
et l’abbé de Berdoues, dont il ne reste que quelques
traces des fortifications. “Capitale” de l’Astarac.
Vic-Bilh : vieux pays. Terroir viticole à cheval sur
trois départements : Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées
et Gers. Situé au sud de l’Adour et sur les coteaux de
Béarn. |
|